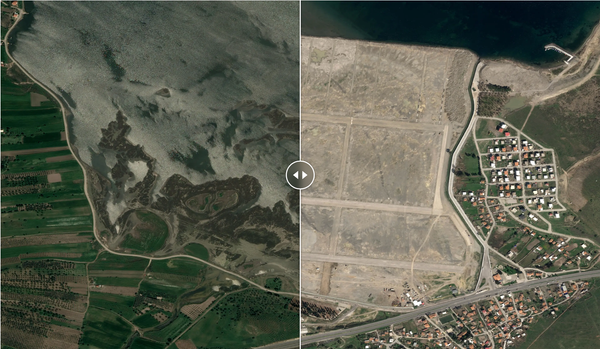👋 Départ de 50% des effectifs

Mars 2019. Premier échange avec Sylvain en visio, sûrement via Skype. Zoom n’existe pas encore, le monde d’après non plus. Alors que je lui demande si je peux faire un stage de quelques mois avec lui pendant mon année de césure, il me répond avec une moue dubitative qu’on peut essayer, mais qu’il va falloir que je sois très autonome. Juste après ce premier échange, assise dans un café coloré et confortable à Guadalajara, au Mexique, je fabule sur ce stage, espérant que peut-être, cette collaboration sera fructueuse et qu’elle durera plus longtemps.
Cela fait 4 ans que j’ai mis “le pied dans la porte”, comme dit Sylvain. En 4 ans, j’ai gribouillé plus de 25 carnets, d’abord annotés d’acronymes incompréhensibles qui regorgent dans le monde de l’urbanisme. Ces sigles, je faisais semblant de les comprendre, puis allais les checker sur Google le soir. Ils ont petit à petit fait place aux to-do-list à n’en plus finir. Entre deux tisanes, environ 140 newsletters ont été programmées le mardi soir, parfois le mercredi à 9h59, quand Sylvain n’avait pas d’inspiration pour son édito. Plus de 80 podcasts ont été réalisés, avec toujours la même ligne éditoriale : interviewer des gens sympas. S’ajoutent quelques éditos et articles, mais surtout un paquet conséquent d’entretiens reformulés. Et bien sûr, la participation à 36 missions de dixit, de la transformation de sites au conseil aux organisations sur la sobriété foncière (analyser des PLU et des PPRI sans s'arracher les cheveux...). C’est d’ailleurs souvent sur le chemin, en voiture ou en train, que j’ai lu un nombre incalculable d’articles et de livres, pour alimenter la vieille de cette newsletter. Enfin, pour finir cette liste à la Prévert, les deux dernières années ont été rythmées par une flanquée d’animation et de formation à la Fresque de la ville, jeu que nous avons créé pendant le confinement.
Je crois sincèrement que je n’aurais pu rêver mieux comme premier travail. J’ai découvert le territoire français avec de nouvelles lunettes, j’ai rencontré énormément de faiseur·ses de ville motivants et inspirants. Je les remercie chaleureusement d’avoir partagé leurs expériences, leurs convictions, comme leurs nécessaires doutes. Au gré de nos missions, de nombreux·ses professionnel·les sont intervenu·es, ce qui m’a permit de toucher du bout du doigt d’autres domaines d’expertise. Je pense tout particulièrement à Marlène et à Maryse. Merci pour m’avoir apporté d’autres points de vue, mais surtout merci pour les aventures en Sarthe et en Mayenne !
Sylvain, merci. Merci de m’avoir fait confiance si rapidement, merci de m’avoir partagé les dessous d’une entreprise, merci d’avoir été un mentor pour mes premières années professionnelles. Et non, je ne t’abandonne pas, je sais bien qu’on continuera à travailler ensemble. N’est-ce pas ce que tu m’as appris sur la collaboration en réseau ? Je garde notamment en tête nos longues discussions, où tu prenais le luxe d’appuyer sur le frein, afin de rassembler des éléments, tirés de nos rencontres et de nos recherches. Plusieurs projets ambitieux sont nés de ces griffonnages sur le tableau velleda, nos réflexions boostées à la tisane aux fruits rouges. Je crois que cette capacité à faire une pause est un luxe nécessaire qu’il me faudra conserver précieusement.
Merci à vous enfin, d’avoir suivi assidument cette newsletter, qui se poursuis encore tous les mercredis ! Elle sera peut-être simplement en retard… En septembre, je débute dans une nouvelle structure, en continuant de porter les enjeux de résilience territoriale et de le redirection écologique. A bientôt donc, sous d’autres formes !
— Frédérique Triballeau (Linkedin)
PS : Un podcast sort aussi cette semaine ! Il s’agit de Vincent Cottet, Paysagiste-urbaniste, associé chez Richez Associés, qui nous raconte le projet Rue Commune, un guide permettant de transformer la rue métropolitaine ordinaire.
📅 Du 5 au 7 juillet, 13ème édition des assises nationales de la biodiversité à Marseille ou en visio. Le programme est riche, avec un focus notamment sur le concept de “One Helth”, mais aussi sur la biodiversité marine et l’artificialisation des sols. (idealCo)
🖍️ Infographies. 11 infographies sur les limites planétaires, pour bien comprendre leurs enjeux, mais aussi des propositions de pistes d’action, de façon plus imagée et plus ludique qu’un gros rapport qu’on ne lit jamais (ou vraiment pas souvent). Elles évoquent le réchauffement climatique, bien sûr, mais surtout des sujets moins connus : la perturbation du cycle du phosphore, l’acidification des océans ou la pollution atmosphérique en aérosols, par exemple. (Millénaire 3)
💥 Insécurités globales. Le thème du nucléaire de cet article n’est finalement qu’un prétexte pour parler plus largement des risques mondiaux et de cette nouvelle ère qu’on pourrait qualifier de “globocide”. Cette fracture causée par l’usage de la bombe nucléaire au milieu du XXème siècle n’aurait pas été comprise par les courants politiques écologistes. La pensée de Bruno Villaba, politologue, propose de faire un pas de côté vis à vis des alternatives locales en remettant le système monde dans la balance. Il y a une obligation vitale de se confronter à ce qui existe déjà, à ces héritages vus comme des “ruines irréversibles” et aux responsabilités qu’elles incombent. (Ecole urbaine de Lyon)
📖 Les penseurs de l’écologie, Collectif (L’OBS et Les Liens qui libèrent, 2023). Un ouvrage au style simple et aux articles courts retraçant le parcours, avec quelques dates et notions clés, de 21 penseurs et penseuses de l’écologie, bien que ce mot puisse être anachronique dans certains cas. On y croise d’abord Saint François et Rousseau, en passant par René Dumont, Françoise D’Eaubonne, jusqu’à Pablo Servigne et Greta Thunberg. La sélection est très européenne, mais pour celles et ceux qui aiment connaître d’où viennent les concepts et les ruptures de la pensée écologique moderne occidentale, c’est un bon résumé.
(…) tous les mots d’ordre sont bons à prendre, tous les chemins à explorer : la cohabitation avec le vivant proposée par les disciples de Latour ; l’environnementalisme des pauvres théorisé par les penseurs décoloniaux ; les petits gestes, façon “colibri”, vantés par Pierre Rabhi ; la convergence des luttes sociales, puisque l’on sait désormais que plus on est riche, plus on pollue ; l’attribution des droits aux entités naturelles ; l’écoféminisme ; le véganisme… Autant de tentatives de “relocaliser le global”, comme dit Bruno Latour.