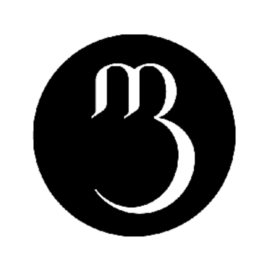🔭 De la planification à la prospective stratégique

Depuis des décennies, nous planifions le futur de nos territoires à travers différents documents : PLU, PLH, SCoT... Mais le changement climatique et la multiplication des turbulences rendent l’avenir incertain et percutent nos méthodes de planification. Alors comment se préparer à l'imprévisible ? Une partie de la réponse réside dans les démarches prospectives. Il ne s'agit plus de se choisir un avenir radieux, mais d’imaginer les différents futurs possibles du territoire, y compris les moins confortables.
Tout commence par un choc, une sidération. Elle peut être réelle : une inondation, un glissement de terrain... Elle peut être aussi fictive : par un voyage dans des futurs inconfortables, mais plausible. Cet évènement peut agir comme un déclencheur. Il fait vaciller les certitudes, sème le doute et ouvre la voie à la réflexion : que voulons-nous préserver, que sommes-nous prêts à abandonner ou transformer ? Cela permet de définir l’élan vital du territoire : quelle est sa force, le désir qui anime intrinsèquement ce lieu et ses habitants ? Il s’agit bien souvent du désir de pouvoir continuer d’habiter ce territoire, et de conserver une qualité de vie, malgré une augmentation des risques.
Une fois l'élan vital défini, il faut embarquer les acteurs du territoire. La prospective n'est pas une démarche solitaire, portée par un petit cercle d'élus ou de techniciens, c'est un processus collectif qui associe progressivement habitants, associations, entreprises, collectivités... Pour mener à bien ces échanges, les territoires peuvent travailler avec des équipes pluridisciplinaires, extérieures au territoire. L'objectif n'est pas de les mettre en compétition, mais de favoriser les regards croisés. Cette diversité de point de vue permet de construire une vision riche, nuancée. Les décideurs gardent un rôle central : ils décident, non pas entre des projets concurrents, mais d'une direction parmi des futurs explorés collectivement, en tenant compte de leurs implications et incertitudes.
Enfin, ce travail ne peut s’affranchir d’un socle environnemental solide. Il est indispensable de penser les transformations territoriales à partir de leurs impacts écologiques. Et cela n’est pas toujours évident : comment intégrer les métriques environnementales dans les représentations territoriales ? Comment dessiner un projet en tenant compte du carbone qu’il émet, des sols qu’il imperméabilise, de la biodiversité qu’il contraint ou favorise ?
Pour en savoir davantage, Sylvain a échangé avec Panos Mantziaras, architecte, docteur en urbanisme et aménagement, et directeur de la fondation Braillard Architectes. Au cours de sa carrière, Panos a travaillé sur différents dispositifs de prospective à Paris, au Luxembourg ou encore à Genève, il nous partage dans cet épisode de podcast les clés pour réussir une démarche prospective, et la nécessité de passer d’une vision planificatrice à une vision prospectiviste.
— Camille Tabart (LinkedIn)
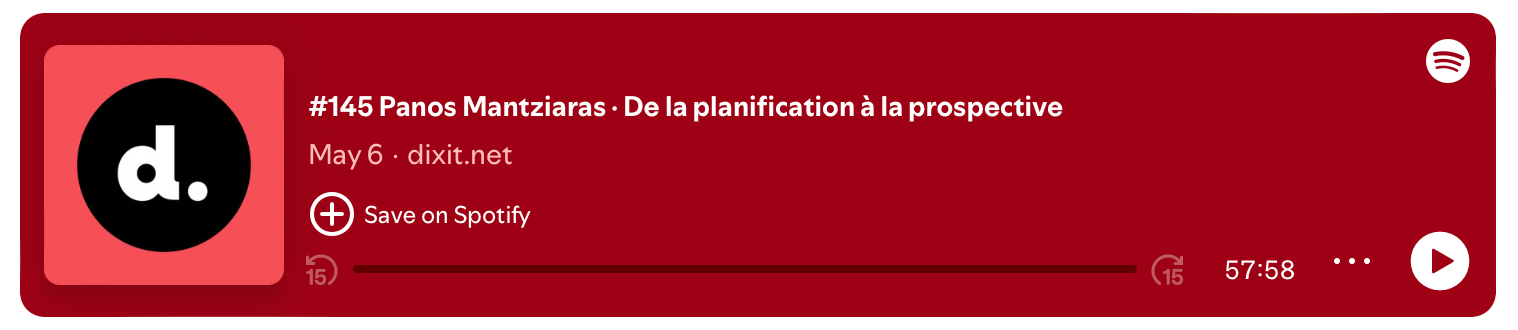
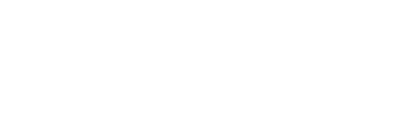
📅 Le 15 mai, Forum de la transiton foncière. Rendez-vous à 16h à Sciences Po Paris, pour cette troisième édition organisée par l’Institut de la Transition Foncière, l'École urbaine et l'Institut des Transformations Environnementales de Sciences Po. Le thème de cette édition : “La gouvernance des sols vivants en Europe : vers un Land New Deal."
🤑 Reconquérir notre citoyenneté économique. Finance à impact, économie collaborative, social business… on aurait tous envie d’y croire. Mais beaucoup de ces termes ne sont que des écrans de fumée nous permettant de croire un peu plus longtemps en la promesse capitaliste de profits éternels. Sébastien Chaillou-Gillette et Stéphane Pfeiffer ne perdent pourtant pas espoir : Un “notre monde” est possible (éditions Les Petits Matins) plaide pour faire revenir l’économie dans le champ de la démocratie, afin que celle-ci ne soit plus l’apanage de quelques-uns au détriment des autres, mais l’affaire de tous, pour l’intérêt commun. L’économie sociale et solidaire n’est que la pointe émergée d’un iceberg qui pourrait faire chavirer le navire capitaliste. Cet iceberg s’appelle la citoyenneté économique. La faire advenir est une affaire d’éducation, de changement d’imaginaire sur le travail, la gouvernance des entreprises et leur recherche de profits… Un autre monde en somme, mais pas une autre planète.
“ Ce qui nous intéresse, ce n’est pas tant l’évolution du modèle capitaliste d’un point de vue économique, mais son arrivée progressive dans le champs de l’intérêt général. (…) C’est finalement notre souveraineté dans l’ordre politique qui est interrogée. Aujourd’hui, privés de notre citoyenneté dans le champ économique, nous devons considérer le recouvrement de notre souveraineté dans ce domaine comme une priorité.”
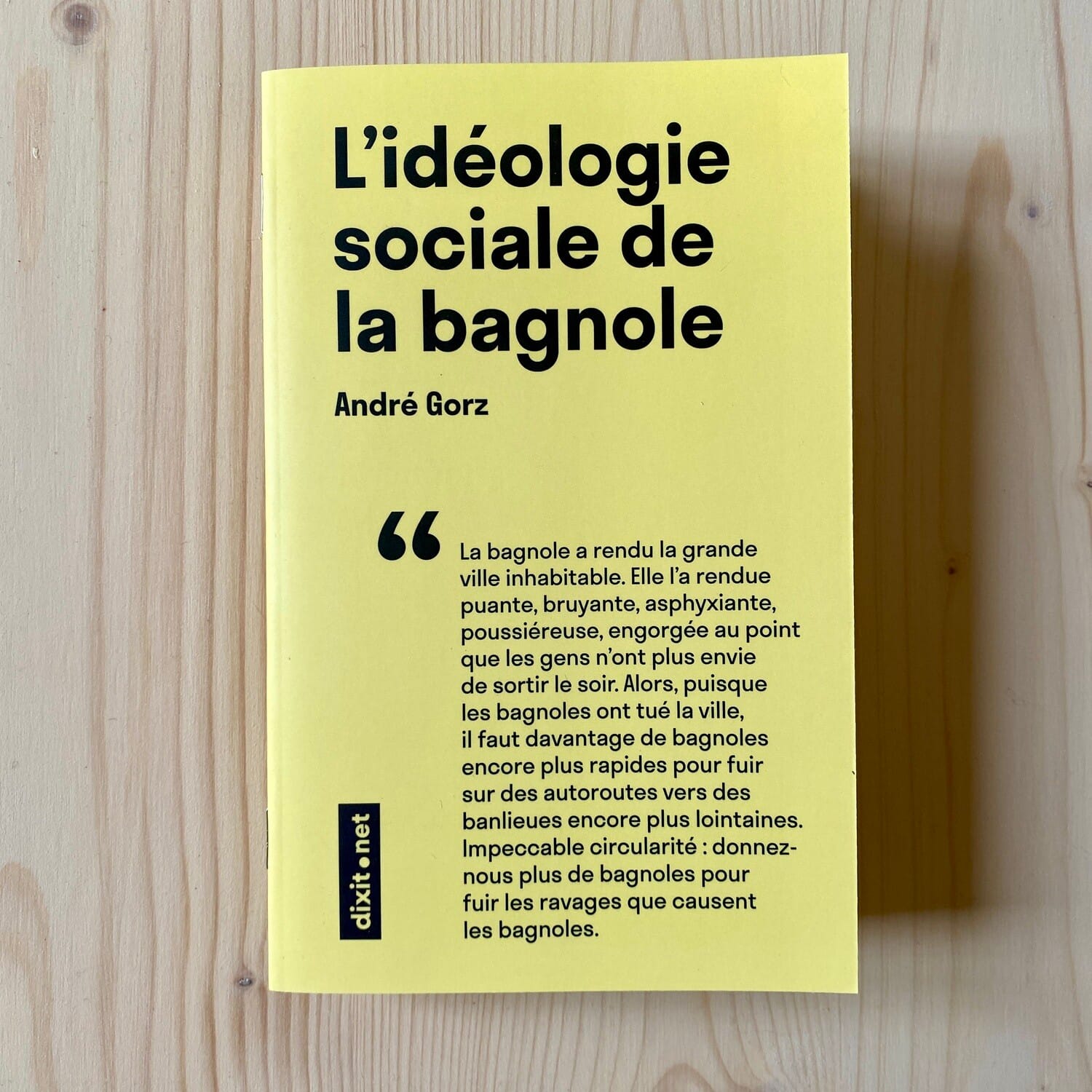
L'idéologie sociale de la bagnole (André Gorz)
"La bagnole a rendu la grande ville inhabitable. Elle l’a rendue puante, bruyante, asphyxiante, poussiéreuse, engorgée au point que les gens n’ont plus envie de sortir le soir. Alors, puisque les bagnoles ont tué la ville, il faut davantage de bagnoles encore plus rapides pour fuir sur des autoroutes vers des banlieues encore plus lointaines. Impeccable circularité : donnez-nous plus de bagnoles pour fuir les ravages que causent les bagnoles."
André Gorz, de son vrai nom Gerhard Hirsch puis Gérard Horst, est un philosophe et journaliste français. Il est cofondateur, en 1964 du Nouvel Observateur, sous le pseudonyme de Michel Bosquet. Sa pensée oscille entre philosophie, théorie politique et critique sociale. Il devient dans les années soixante-dix l'un des principaux théoriciens de l'écologie politique et de la décroissance.