🗝️ Faire place à l'utilité sociale
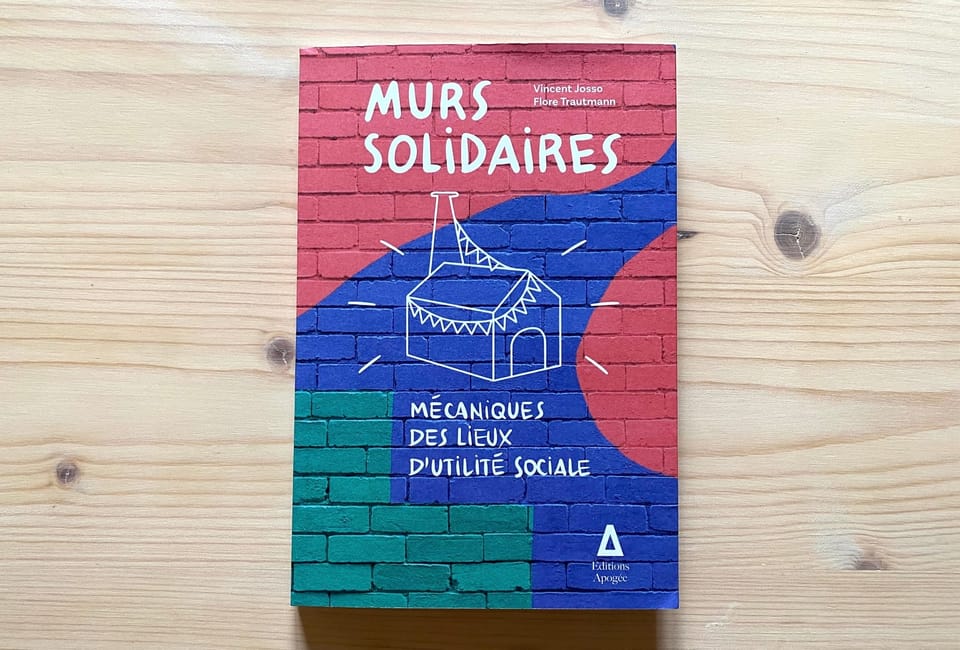
Le meilleur moyen de favoriser des activités d’utilité sociale est sans doute de leur mettre un toit au-dessus de la tête. Un toit ou des murs, pour suivre le titre de l’ouvrage par Vincent Josso et Flore Trautman Murs solidaires, mécaniques des lieux d’utilité sociale aux éditions Apogée.
Qu’est-ce que l’utilité sociale ? Les termes sont tellement vastes qu’on pourrait s’y perdre. Mais au lieu de rester dans des débats stratosphériques, les auteurs précisent en un chapitre leur acception du terme, et plus important encore, les critères choisis pour l’objectiver et le faire atterrir :
« Nous identifions trois composantes principales de l’utilité sociale :
- le domaine d’activité et les objectifs poursuivis : cohésion sociale, lutte contre les inégalités, lutte pour la sobriété énergétique, éducation, etc
- une gouvernance démocratique et/ou collégiale
- une lucrativité limitée »
Une fois les termes posés, encore faut-il éviter de mettre dos à dos services publics et initiatives citoyennes, associatives ou entrepreneuriales. Loin de les présenter comme deux sphères hermétiques et incompatibles, le livre pose au contraire un cadre pour une alliance saine et durable. Car si le public est de moins en moins capable de tout « faire », cela l’oblige en aucun cas à tout « laisser faire ». Le livre ouvre une troisième voie : « faire avec », en recomposant les rapports entre économie et société.
Les auteurs produisent un guide pour ouvrir des portes aux porteurs d'activité d'utilité sociale. C’est un guide concret, illustré par toute une série d’exemples : on y parle d’une auberge coopérative en Ardèche, d’un tiers lieu écologique au Havre, d’un pôle entrepreneurial solidaire au cœur de Bordeaux, de l’une des dernières zones d’activités productives dans Paris intra muros, ou encore d’une occupation transitoire au sein de la capitale.
Aucune des difficultés des parties prenantes n’est occultée. Côté entrepreneurs les solutions précarisent souvent l’occupant, ou bien se font au détriment de son cœur de métier. Côté collectivités, les subventions sont souvent « à fonds perdus » et les mise à disposition de locaux risquent de générer des effets d’aubaine à long terme.
Alors face à tous ces problèmes, comment bien répondre à ce besoin matériel fondamental ? Les auteurs énoncent les solutions trouvées par les uns et les autres, sur le terrain. L’immobilier, nœud du problème pour beaucoup, devient la solution via des partenariats qui prennent des formes les plus diverses : outils de portage foncier, structures juridiques, instruments financiers originaux… autant de briques pour bâtir des murs solides à des projets d’utilité sociale à disposition de celles et ceux qui veulent se lancer.
Ce livre est à la fois optimiste et pragmatique : le monde regorge d’initiatives à but solidaire qui fonctionnent, et il nous explique comment. Avec toujours une même condition clef à ces réussites : la capacité des acteurs à coopérer.
— Lucie Carpentier (LinkedIn)
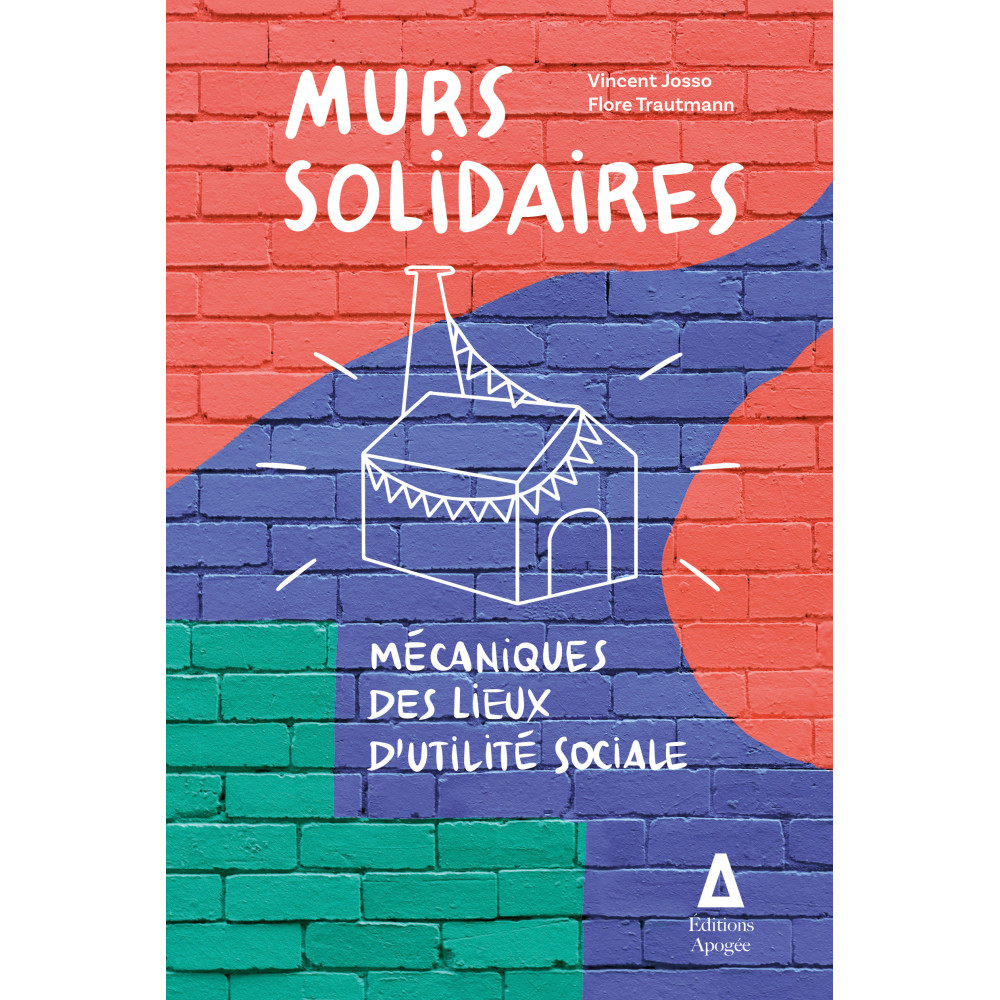
📆 Jusqu'au 16 février, Sélection des Jeunes Architectes et Paysagistes Ligériens (JAPL). L'appel à candidatures pour la 5e édition de la Sélection JAPL est ouvert. Cette initiative met en lumière la créativité et l'engagement des jeunes concepteurs et conceptrices qui imaginent de nouvelles pistes pour les espaces bâtis et paysagers de demain.
📙 Pour les sans-voix de Christophe Robert (Éditions Arthaud). Christophe Robert est délégué général de la Fondation Abbé Pierre (qui va devenir la Fondation pour le Logement des défavorisés) depuis 10 ans. Dans cet ouvrage, il dresse un état des lieux des inégalités économiques en France et démontre que les dispositifs d'aide et de redistribution des richesses manquent souvent d'efficacité — allant parfois jusqu'à creuser les inégalités. Il montre aussi comment la pauvreté freine la lutte contre le changement climatique en plus d'en décupler les effets. Le livre ne se contente pas de dresser un portrait pessimiste, il expose également des leviers d'action permettant d'endiguer ces inégalités, en soulignant le rôle crucial des politiques publiques : il est impératif de préserver les aides aux plus précaires et de renforcer l'imposition pour mieux répartir les richesses.
La dimension sociale de la transition écologique est cruciale. Au point que les réformes à mener ne pourront être conduites qu'à la condition que les mesures mises en œuvre soient justes et ne provoquent pas davantage d'exclusion et d'inégalités.







