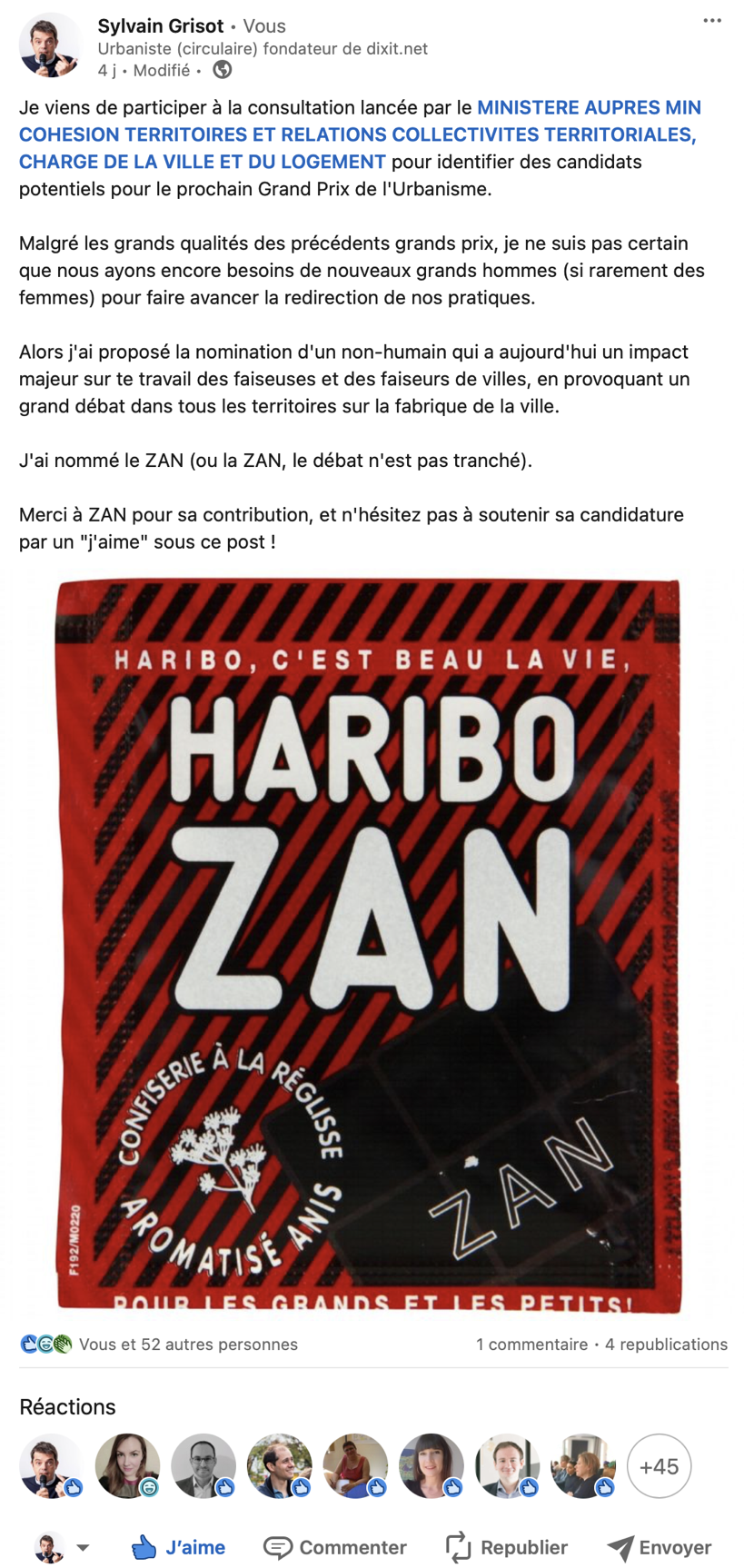🧸 La nouvelle vie de l’usine Gégé

Vos parents ou vos grands-parents ont sans doute eu des jouets ou des poupées Gégé quand ils étaient petits, et peut être même vous-même. Il s'agissait de jouets français fabriqués à Montbrison, une ville moyenne située entre Clermont-Ferrand et Lyon. Fondée dans les années 1930, cette entreprise a prospéré pendant plusieurs décennies avant de connaître le déclin dans les années 1970, jusqu’à sa fermeture définitive en 1979.
La mairie rachète le site en 1991, mais malgré ses tentatives de réhabilitation le site reste en friche pendant 40 ans. Il faut dire que sa rénovation est notamment contrainte par sa dimension patrimoniale, car l'ancienne usine Gégé est classée « immeuble d'intérêt patrimonial majeur ». Un classement justifié par son architecture marquante des bâtiments industriels des années 1930, mais aussi parce que le bâtiment représente une partie de l'histoire locale, et de nombreux habitants ont un membre de leur entourage qui a travaillé dans cette usine. L'enjeu de la réhabilitation est donc de transformer le bâtiment tout en conservant son architecture et en mettant en valeur son histoire.
En 2018, le PUCA et l'ANCT lancent le dispositif « Réinventons nos cœurs de ville » à destination des villes participant au programme « Action Cœur de Ville ». La mairie de Montbrison décide de soumettre une candidature pour permettre la réhabilitation de cette friche industrielle. L'appel à projet est lancé en juillet 2019, et en octobre 2020, un groupement inédit, composé d'un bailleur social, d'un aménageur et de deux promoteurs, est désigné lauréat. Pour intégrer le site dans le tissu urbain existant, le projet prévoit de transformer le bâtiment industriel en logements, de construire quelques logements individuels, des commerces, des services et de créer un espace public pour accueillir un marché en plein air. La mixité sociale et intergénérationnelle est au cœur du projet, car elle permet d’apporter une réponse au vieillissement de la population. Pour cela, des logements sociaux adaptés aux seniors sont prévus, ainsi qu'un pôle de santé.
Pour comprendre plus en détail ce projet, j'ai rencontré Kevin Brun, chargé de projet Action Cœur de Ville à l'agglomération Loire Forez. Ce que j'ai retenu de cet échange, c'est que la réhabilitation d’une friche est une recette complexe qui nécessite au moins 4 ingrédients essentiels. De l'argent évidemment, avec quelques millions d'euros de déficit dans le cas du projet Gégé. Un portage politique ensuite, qui a besoin de s’appuyer sur un vrai accompagnement en ingénierie. Mais il faut surtout du temps, un tel projet ne se monte pas en quelques mois, il faut plusieurs années pour affiner le projet, définir clairement le périmètre d'action, et identifier les enjeux.
Je vous laisse découvrir cet entretien dans le podcast ci-dessous. Bonne écoute !
Camille Tabart (LinkedIn)
PS : Prochains rendez-vous autour de la Redirection urbaine :
- à Nantes jeudi 11 avril à 18h à la Maison de l'Architecture des Pays de la Loire
- à Genève mardi 23 avril à 19h au Palladium
- à Fribourg mercredi 24 avril à 18h30 avec Archiclimat

📆 Du 1er avril jusqu’au 30 juin, MOOC « les outils de la ville durable ». L’ADEME et le CNFPT proposent de nouvelles sessions du MOOC Villes et Territoires durables : outils et méthodes pour passer à l’action. Il est destiné aux acteurs de la ville durable, à toutes les personnes intéressées par le thème et/ou qui travaillent dans le domaine de l’urbanisme, avec pour objectif de former aux méthodes et outils relatifs aux quatre grands piliers de la ville durable : la sobriété, la résilience, l’inclusion et la santé, et enfin la créativité. (Informations et inscription)
🚌 Mobilités. Le Cerema a récemment mis en ligne une publication portant sur « les mobilités dans les territoires peu denses, un enjeu de cohésion territoriale ». Les territoires peu denses regroupent une grande diversité de territoires : ruraux, périurbains, petites et moyennes villes… mais tous ont en commun d’avoir des offres de transport en commun peu développées car le tissu socio-économique est dispersé. Ainsi la voiture est omniprésente, avec de fortes inégalités d’accès aux commerces et services pour les personnes ne pouvant pas conduire. Mais cette dépendance à la voiture n’est pas une fatalité, des solutions existent et peuvent être mises en place à l’échelle des territoires. Agir sur la mobilité ne permet pas seulement une meilleure accessibilité aux commerces et services, c’est aussi un moyen de lutter contre les inégalités socio-économiques, de réduire l’impact climatique des déplacements individuels, et de dynamiser certaines parties du territoire. La diversité des territoires peu denses ne permet pas de mettre en place une solution duplicable, c’est pourquoi le Cerema propose plutôt une méthodologie d’action pour agir sur les mobilités. Cette méthode est basée sur la connaissance des besoins du territoire, la co-construction du projet par les différents acteurs territoriaux, et l’expérimentation de modes de déplacement pour ajuster le projet aux besoins des usagers. (Cerema)
🌜 Nuit. Longtemps vue comme un temps d’arrêt dans la vie urbaine, la nuit prend progressivement de l’importance dans nos vies, et commence à être bien investiguée par les chercheurs comme un champ de recherche interdisciplinaire à part entière. La nuit rend plus lisibles certaines tensions économiques, sociales ou environnementales qui traversent la société. Cet espace-temps particulier soulève des enjeux d’accessibilité aux différents services ouverts, de préservation de la biodiversité, de cohabitation des usages entre ceux qui dorment, ceux qui travaillent et ceux qui s’amusent. Luc Gwiazdzinsky y voit l’occasion de développer un urbanisme nocturne sensible. (AOC)
🗺️ Imaginer Demain, chroniques cartographiques d’un monde à venir. Les cartes ont pour objectif de représenter les territoires, d’informer le lecteur, mais elles ont aussi la capacité de nous faire voyager, de stimuler notre imagination. En s’appuyant sur cette capacité qu’ont les cartes à nous projeter dans des territoires inconnus, Julien Dupont imagine alors les cartes de futurs plus ou moins lointains et plausibles. Pour créer ces cartes, il s’appuie sur des rapports scientifiques ou des récits de science-fiction. Chaque carte s’accompagne d’un texte explicatif pour montrer quels phénomènes ont mené à cette situation. Ces cartes parfois dystopiques ne montrent pas ce que le futur sera, mais ce qu’il pourrait être, et elles nous invitent à l’action pour construire d’autres futurs plausibles, car le futur s’écrit aujourd’hui. (Dunod)